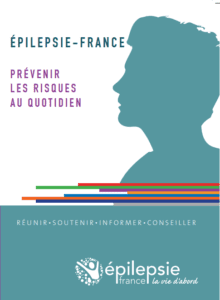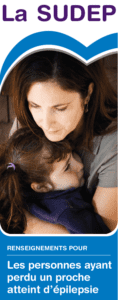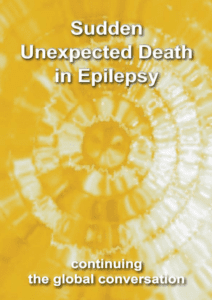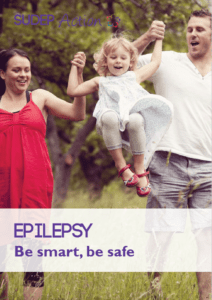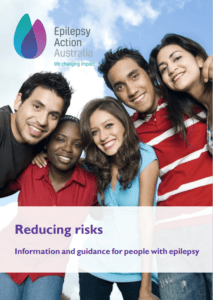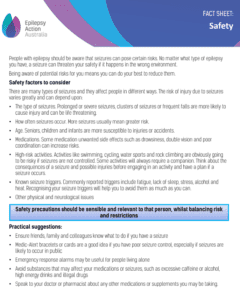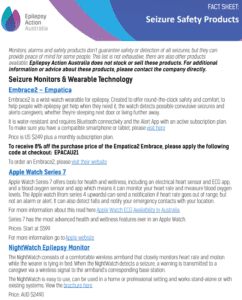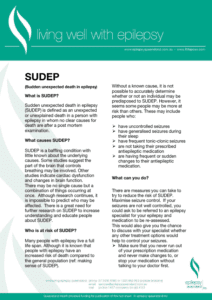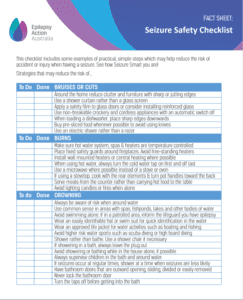Les publications du réseau RSME
Les plaquettes
Si vous souhaitez obtenir des exemplaires papier, envoyez un mail à l'adresse rsme@chu-montpellier.fr en précisant votre adresse postale.
Les autres publications
Articles tout public
Articles scientifiques
- Stratifying sudden death risk in adults with drug-resistant focal epilepsy: The SUDEP-CARE score. Serrand C, Rheims S, Faucanié M, Crespel A, Dinkelacker V, Szurhaj W, Biraben A, Bartolomei F, de Grissac N, Landré E, Denuelle M, Vercueil L, Marchal C, Maillard L, Derambure P, Dupont S, Navarro V, Mura T, Jaussent A, Macioce V, Ryvlin P, Picot MC.Eur J Neurol. 2023 Jan;30(1):22-31. doi: 10.1111/ene.15566. Epub 2022 Sep 27.PMID: 36094672
- Cardiac Autonomic Dysfunction and Risk of Sudden Unexpected Death in Epilepsy.
Szurhaj W, Leclancher A, Nica A, Périn B, Derambure P, Convers P, Mazzola L, Godet B, Faucanie M, Picot MC, De Jonckheere J.Neurology. 2021 May 25;96(21):e2619-e2626. doi: 10.1212/WNL.0000000000011998. Epub 2021 Apr 9.PMID: 33837114
Les communications aux congrès
- Communication affichée : The French Sentinel network on epilepsy-related mortality - IEC 2011, Rome (English documentation)
- Communication affichée : Le Réseau Sentinelle Mortalité Épilepsie : Fonctionnement et premier bilan - JFE 2011, Bordeaux
- Communication affichée : Épilepsie et mortalité : les actions du Réseau Sentinelle Mortalité Épilepsie (RSME) - JFE 2012, St Malo
- Communication affichée : Quelle information pour les proches de patients souffrant d'épilepsie ? Premiers résultats issus des entretiens auprès des familles endeuillées de l'étude PRERIES - JFE 2012, St Malo
- Communication affichée : Besoins et attentes des familles endeuillées au moment et à distance du décès de leur proche - JFE 2013, Lille
- Communication affichée : Mortalité et épilepsie : ce que nous apprennent les signalements effectués au Réseau Sentinelle Mortalité Épilepsie. Analyse des 86 premiers cas de SUDEP - JFE 2013, Lille
- Communication affichée : Facteurs de risque de SUDEP (Étude PRERIES) : Description des 64 premiers cas de SUDEP - JFE 2014, Nancy
- Communication affichée : Épilepsie & Risques : de quelle information disposent les patients - JFE 2014, Nancy
- Communication affichée : Réseau Sentinelle Mortalité Épilepsie, bilan et perspectives après 5 ans de fonctionnement - JFE 2015, Montpellier
- Communication affichée : Ce que recommanderaient les familles sur les informations à donner à leurs proches souffrant d'épilepsie - JFE 2015, Montpellier
- Communication affichée : Mortalité liée à l'épilepsie chez les enfants et adolescents : analyse des 38 SUDEP signalées au réseau RSME - JFE 2016, Toulouse
- Communication orale : Utilisation des systèmes de détection des crises en France - JFE 2016, Toulouse
- Communication affichée : Étude des facteurs de risque de SUDEP (PRERIES) : Caractéristiques des 100 premiers cas de SUDEP - JFE 2018, Lyon
- Communication affichée : Comment penser la prévention des risques liés à l’épilepsie à partir de l’expérience de patients, de proches et de proches endeuillés : étude qualitative phénoménologique – JFE 2019, Paris
- Communication affichée : Facteurs de risque de mort soudaine inattendue (SUDEP) chez des patients avec épilepsie partielle pharmacorésistante – JFE 2019 – Paris
- Communication affichée : SUDEP et risques liés à l’épilepsie, quels supports de communication sont disponibles sur le net en 2022 – JFE 2022, Grenoble
Documentation SUDEP
Articles sur les SUDEP
Documentation soutien aux familles endeuillées
Étude épilepsie et mortalité modélisée chez l'animal - Projet d'un réseau de recherche français
Hypothèses
Le taux de mortalité normalisée chez les personnes épileptiques (nombre de décès recensés dans une population épileptique en comparaison à une population de référence après corrections sur le sexe, l'âge etc) est compris entre 1,6 et 5,3 selon les études.
Les SUDEP (Sudden unexpected death in epilepsy), définies par la mort inexpliquée, non traumatique et non consécutive à une noyade, avec ou sans signes attestant qu'une crise a précédé le décès, pour lequel l'autopsie n'a pas permis d'expliquer le décès, est la cause majeure du taux élevé de décès dans la population épileptique.
Les facteurs de risques ont été évalués et beaucoup d'études mettent an cause la survenue probable d'une crise d'épilepsie avec une prépondérance des facteurs cardio-respiratoires et tout particulièrement des apnées centrales et obstructives et les arythmies cardiaques. La génétique ne permet pas d'identifier des causes simples et on doit admettre qu'il existe un grand nombre de gènes intervenant comme facteurs de susceptibilité.
Plus simplement, on peut raisonnablement proposer trois hypothèses majeures concernant la surmortalité chez les personnes épileptiques. Une hypothèse cardiaque, une hypothèse respiratoire et une hypothèse métabolique et leurs interactions. D'autre part, quel qu'en soit le mode d'action, aujourd'hui inconnu, la sérotonine (5HT) semble jouer un rôle important.
Réseau Expérimental et forces vives
Des chercheurs issus de sept unités scientifiques émargeant à l'Inserm et au CNRS, réparties dans 5 villes françaises (Lyon, Marseille, Montpellier, Nice, Rennes) ont constitué un réseau expérimental pour répondre à ces questions.
Ces sept unités sont toutes reconnues par la communauté épileptologique.
Projet scientifique et logique du groupe
Chacune des sept unités a la double compétence de pratiquer des recherches en épileptologie et des recherches dans les domaines génétique, cardiaque ou respiratoire.
Plus concrètement les équipes engagées apportent soit des modèles animaux d'épilepsie - rat ou souris - appropriés pour l'étude envisagée (une mutation entraînant une insuffisance respiratoire par exemple), soit des techniques permettant des analyses cardiaques ou respiratoires. C'est donc sans a priori et à partir de ces modèles animaux essentiellement génétiques que le réseau s'attelle à étudier les différentes hypothèses cardiaques, respiratoires, cardio-respiratoires et métaboliques. Chaque modèle animal a sa spécificité propre et son apport potentiel propre et la meilleure stratégie repose sur une mise en commun des modèles et techniques caractérisant chaque unité.
La logique de groupe consiste donc à favoriser les échanges bilatéraux entre unités porteurs de modèles animaux et celles expertes pour répondre aux hypothèses posées.
Pour les spécialistes qui veulent en savoir plus
Le Réseau utilise trois modèles expérimentaux, trois modèles génétiques souris et un modèle induit de façon chimique chez le rat. Trois modèles sont illustrés ci-dessous reflétant la diversité des approches. Un premier modèle (en miroir) est constitué de deux lignées de souris consanguines, CBA/J et CBA/H qui, suite à une injection de MSO (méthionine sulfoximine), présentent plusieurs heures après l'injection, des convulsions généralisées tonico-cloniques (CGTC).
La différence entre les deux lignées résulte dans le fait que CBA/J ne survit pas à la CGTC contrairement à CBA/H. Ces deux lignées sont génétiquement proches et la latence de convulsion moyenne est statistiquement équivalente entre les deux lignées. L'intérêt d'employer la MSO réside dans le fait qu'elle induit des convulsions longtemps après l'injection. Ce délai devrait faciliter les enregistrements pour tout paramètre physiologique d'intérêt.
Et on peut s'attendre à des modifications progressives des mécanismes mis en jeu pour aboutir à la CGTC. La MSO entraîne deux effets probablement indépendants. D'une part, elle induit des convulsions comme vu précédemment et d'autre part, elle intervient sur le métabolisme glucidique.
La différence observée entre les lignées CBA/J et CBA/H pourrait donc s'expliquer par une voie métabolique, en plus des voies cardiaques et respiratoires, même s'il est difficile de favoriser cette hypothèse. Cette dernière peut être levée en appliquant un régime cétogène aux animaux ou en contrôlant si une hypoglycémie induit des crises.
Le deuxième modèle repose sur l'emploi de la souris knock-out (invalidée) pour le gène Necdin employé pour l'étude du syndrome de Prader-Willi. Cette souris possède des caractéristiques faisant d'elle, un modèle probablement très informatif pour l'étude de la surmortalité liée aux épilepsies. Effectivement on observe chez les animaux invalidés (Nectin -/-) des apnées et des modifications des activités 5HT et surtout des modification dans les réponses à la 5HT. Le troisième modèle est le rat pilocarpine, un modèle d’épilepsie du lobe temporal (ELT). Il est utilisé par de nombreux laboratoires à travers le monde.
Il présente de nombreuses homologies avec l’ELT chez l’Homme au niveau physio-pathologique. L’injection de pilocapine déclenche un status epilepticus, qui va enclencher l’épileptogenèse. Ce modèle est caractérisé par une phase de latence, pendant laquelle l’animal ne présente pas de crises spontanées. Au bout de deux semaines environ les premières crises spontanées apparaissent.
Il est donc possible d’étudier deux phases : la phase de latence qui conduit à l’épilepsie et la phase chronique avec des crises.Ces deux phases existent aussi dans l’ELT chez l’Homme après une agression du cerveau (méningite, traumatisme crânien). Ce modèle est caractérisé par la mort spontanée d’animaux pendant la phase de latence ou la phase chronique (entre 10-20 %).L’analyse de l’EEG n’a pas relevé d’anomalies particulières précédant la mort de l’animal (comme une crise importante). D’autres facteurs ont donc conduit à la mort de l’animal. Ces facteurs pourraient être une détresse respiratoire et/ou un arrêt cardiaque. C’est pourquoi une équipe a décidé d’implanter des animaux afin de mesurer leur EEG et leur ECG simultanément.Les données préliminaires montrent la présence claire d’arythmies cardiaques pendant, mais aussi entre, les crises. On constate aussi des périodes de tachycardie. Ces données justifient l’étude de l’origine de ces modifications, et leur impact sur la mort de certains animaux.
Investigateur / coordonnateur
Benoît Martin : benoit.martin@univ-rennes1.fr
Quelles sont les actualités récentes concernant l'épilepsie pédiatrique qui vous ont interpellées ?
“Dans l’épilepsie-absence de l’enfant, il y a une présence d’automatisme durant les absences au moment du diagnostic” Blandine Dozieres, pédiatre à l’Hôpital Debré à Paris.
Quand peut-on parler de syndrome de Lennox-Gastaut chez l'enfant pour envisager des thérapies spécifiques ?
“Tous les symptômes peuvent ne pas être présents dès le début des crises” Rima Nabbout est neuropédiatre à l’Hôpital Necker à Paris.
Quel est l'apport des microélectrodes intracérébrales dans l'épilepsie ?
“On peut maintenant suivre l’activité de neurones uniques chez les patients” Vincent Navarro, neurologue au sein de l’unité fonctionnelle du groupement hospitalier La Pitié Salpêtrière-Charles Foix.
Comment, à votre avis, faut il organiser le bilan étiologique lors de la survenue d’un état de mal épileptique ?
“L’étiologie est un facteur déterminant du pronostic et du traitement de l’état de mal” Luc Valton, neurologue au CHU de Toulouse.
Quels sont les avantages des technologies organiques dans l'épilepsie ?
“Pour que ce soit biocompatible, les électrodes doivent être faites à base de carbone” Christophe Bernard, directeur de recherche Inserm à l’Institut des neurosciences de l’Université de Marseille.
A-t-on encore besoin de nouveaux traitements pour le syndrome de Lennox-Gastaut ?
“Le cannabidiol a eu une AMM européenne en adjonction au clobazam dans le syndrome de Lennox-Gastaut” Stéphane Auvin, neuropédiatre à l’hôpital Debré à Paris.
Quelles nouvelles pistes thérapeutiques pour la sclérose hippocampique ?
“Dans la sclérose hippocampique, un tiers des patients sont pharmacorésistants” - Thomas Marissal, chercheur à l'Institut de neurobiologie de la Méditerranée, à Marseille.