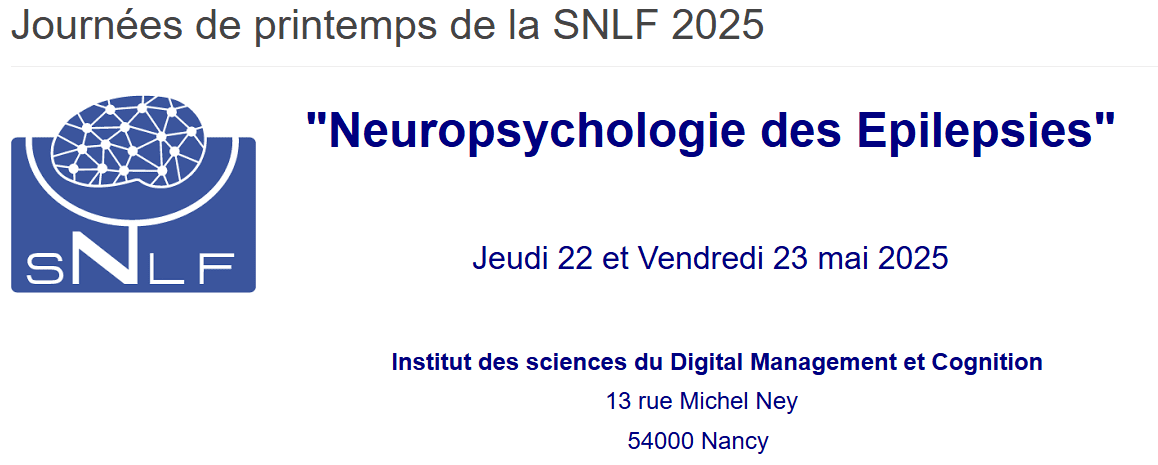Stanislas LAGARDE (1,2)
- Département de Rythmologie Cérébrale et d'Épileptologie (membre du réseau ERN EpiCARE) APHM Hôpital Timone, Marseille, France
- Institut de Neurosciences des Systèmes (INS), Aix-Marseille Université, INSERM, Marseille, France
Pour les patients atteints d'épilepsies focales réfractaires, la chirurgie de l'épilepsie représente l'option de traitement la plus efficace. Beaucoup de ces patients nécessitent une investigation EEG intracrânienne (iEEG) pour délimiter la zone épileptogène (EZ, zone principalement responsable des crises) et sa relation avec les cortex éloquents. Les avancées dans l'investigation iEEG, notamment l'analyse et la quantification des signaux, ont montré que l'EZ implique souvent plusieurs régions cérébrales avec des décharges épileptiques interictales et ictales simultanées. Cela a conduit à un changement de paradigme, repensant l'EZ comme un réseau de régions interconnectées plutôt qu'un seul foyer à partir duquel les activités épileptiques se propagent aux zones environnantes 1. De plus, de nombreuses méthodes ont été développées pour évaluer la synchronisation des signaux électrophysiologiques cérébraux, évaluant ainsi la connectivité fonctionnelle (FC) cérébrale. Les études ont démontré que des altérations de la FC existent également pendant la période interictale (à distance des crises) et sont liées à l'épileptogénicité 2. Il est maintenant bien établi que, dans diverses formes d'épilepsie focale, les régions au sein de l'EZ sont plus interconnectées que les régions en dehors de l'EZ. En outre, il existe une connexion préférentielle entre les zones où les crises débutent et les zones où les crises se propagent, plutôt qu'avec les zones non impliquées pendant les crises. Les recherches ont également indiqué que les schémas de FC interictale corrèlent avec les résultats chirurgicaux : une FC plus élevée au sein de la zone réséquée est associée à un résultat favorable, tandis qu'une FC plus élevée en dehors de l'EZ est liée à un résultat défavorable. Par conséquent, évaluer la performance diagnostique de la FC interictale pour délimiter l'EZ est devenu une étape logique, avec des études démontrant des performances prometteuses 3.
Les progrès dans les analyses de FC ont également conduit à l'émergence d'hypothèses conceptuelles pathophysiologiques. Par exemple, en utilisant des évaluations multivariées (MVAR) et basées sur Granger de la FC (c'est-à-dire en considérant le passé de plusieurs séries temporelles pour prédire l'avenir d'une série temporelle d'intérêt), des méthodes comme la Coherence Partielle Dirigée (PDC) permettent d'estimer la directionnalité de la FC et de déterminer si une région en dirige une autre en contrôlant les connexions indirectes. En moyennant toutes les connexions d'une région cérébrale (un nœud), il est possible d'estimer son comportement en tant qu'émetteur/source ou récepteur/puit au sein du réseau de FC. De manière intéressante, plusieurs études ont indiqué que pendant la période interictale, l'EZ agit principalement comme un puit, avec une connectivité fonctionnelle (FC) entrante plus importante que la FC sortante. Cette FC entrante est plus élevée que celle observée dans les régions en dehors de l'EZ, tandis que la FC sortante reste comparable 3–5. Il a également été démontré que l'utilisation de telles FC dirigées permet une meilleure détermination de l'EZ que la FC non dirigée. Cependant, il convient de noter que ce comportement de ‘puit’ (sink en anglais) n'a pas été reproduit dans toutes les études (par exemple, des études utilisant l'estimation bivariée de la FC et d'autres sur la dysplasie corticale focale ont suggéré une FC sortante plus élevée depuis l'EZ). Cette divergence pourrait provenir des différences dans les méthodes utilisées, les analyses multivariées étant obligatoires pour réveler de tels schémas, et/ou de l'impact des décharges épileptiformes interictales (IEDs). Des questions ouvertes subsistent quant à l'importance de ces schémas dans la FC globale et leur cohérence entre les patients, les études précédentes ayant été réalisées au niveau du groupe. De plus, développer des méthodes pour extraire les principaux schémas de FC sans hypothèses préalables est crucial. Ces questions sont abordées dans l'étude de Doss et al. récemment publiée dans Brain 6.
Dans cet article, les auteurs ont estimé la FC en utilisant une analyse multivariée sur le domaine de fréquence (PDC) des séries temporelles en SEEG (stereo-EEG) de 81 patients avec diverses formes d'épilepsie et localisations de l'EZ. À partir de cette FC dirigée, ils ont pu analyser les forces relatives des connexions sortantes et entrantes de chaque nœud (c'est-à-dire des canaux bipolaires SEEG). La nouveauté de cette étude réside dans la mise en œuvre d'une technique de décomposition sans hypothèse a priori spécifique, l'analyse en composantes principales (PCA) de la matrice de FC pour séparer plusieurs schémas de FC (composantes PCA) qui pouvaient être classés par ordre décroissant de variance expliquée. De manière intéressante, parmi les cinq premières composantes, les auteurs ont trouvé une composante avec une forte FC entrante et une faible FC sortante chez tous les patients, qu'ils ont appelée la composante de « l'Hypothèse de Suppression Interictale » (ISH). Cette découverte confirme la cohérence de ce schéma de FC entre les patients, indépendamment du type d'épilepsie focale. Chez certains patients, cette composante ISH était classée en premier, expliquant la plus grande variance des données (environ 15% de la variance = groupe PC1), tandis que chez d'autres, elle expliquait moins de variance (environ 20% de la cohorte = groupe PC2). Les auteurs ont ensuite examiné la distribution spatiale de cette composante ISH, en se concentrant sur la participation relative de chaque nœud (poids du canal dans la composante). Ils ont constaté que les nœuds au sein de l'EZ étaient significativement surreprésentés dans cette composante ISH par rapport aux autres régions, suggérant que l'EZ a une FC entrante plus élevée que la FC sortante. Les informations issues de l'analyse PCA ont permis de différencier l'EZ des autres zones dans les deux groupes de patients, mais particulièrement fortement dans le groupe PC1. Bien que les résultats principaux aient été présentés dans la bande alpha, ils sont restés robustes dans toutes les sous-bandes, confirmant que le schéma n'est pas spécifique à une fréquence. Enfin, les auteurs ont examiné les caractéristiques de leurs deux groupes de patients sans trouver de différences cliniques significatives, en particulier concernant les résultats chirurgicaux. Cependant, il y avait des différences dans l'échantillonnage spatial du SEEG avec moins de NIZ échantillonnés dans le groupe PC2, ce qui pourrait expliquer la plus grande difficulté à capturer le schéma ISH dans ce sous-groupe. Malheureusement, il reste incertain si l'identification des nœuds appartenant à l'EZ à partir de la composante ISH est plus facile que de les identifier à partir de la matrice de FC brute, car cela n'a pas été testé formellement. Néanmoins, certains résultats pràsentés ont montré une plus grande différence de magnitude entre l'EZ et les autres zones en utilisant la FC reconstruite à partir de la composante ISH, suggérant que des études futures abordant cette question seraient utiles.
Dans l'ensemble, ce travail renforce l'observation d'une FC sortante plus élevée et d'une FC entrante plus faible dans l'EZ, démontrant que de tels schémas sont communs entre les patients et représentent souvent le schéma le plus significatif dans la matrice de FC. Cette découverte a des implications conceptuelles, changeant notre vision de l'EZ d'une source d'informations excitatrices ou perturbatrices vers d'autres zones cérébrales (une vision dérivée des dynamiques temporelles observées pendant les crises et la propagation des IED; notamment, dans cette étude, nous ne connaissons pas l'effet des IED) vers l'EZ étant un récepteur ou un puit pendant les états interictaux. De manière intéressante, des études antérieures ont montré que ce schéma pourrait s'inverser pendant les crises, l'EZ devenant la région leader 4. Les auteurs conceptualisent cette observation comme une information inhibitrice envoyée depuis les zones non-EZ vers l'EZ pour prévenir les crises (hypothèse de suppression interictale ISH), reflétant le concept d'inhibition périphérique observée pendant les crises 7. Cependant, il ne peut être directement déduit que la connectivité entrante plus élevée vers l'EZ est inhibitrice, car la FC ne peut distinguer entre la transmission inhibitrice et excitatrice. Des études translationnelles corrélant la FC dirigée avec une évaluation microscopique de la neurotransmission dans les circuits neuronaux et une modélisation réaliste à grande échelle des masses neuronales 8 pourraient résoudre cette question. De plus, comme les observations sont au niveau du nœud, il reste incertain si cette FC entrante accrue provient de régions en dehors de l'EZ ou d'autres zones au sein de l'EZ, car aucune étude spécifique sur ces connexions n'a été menée à ce jour. De plus, comme les études iEEG n'incorporent pas de groupes de contrôle non épileptiques, il est incertain si l'augmentation observée de la FC entrante au sein de l'EZ reflète une véritable amélioration par rapport aux conditions physiologiques normales ou une diminution de la FC entrante dans les régions en dehors de l'EZ, ce qui produirait un déséquilibre similaire de FC entrante plus élevée et FC sortante plus faible dans l'EZ par rapport à l'ensemble du réseau échantillonné en SEEG. Notamment, les seules études iEEG pouvant comparer la FC entre les patients avec et sans épilepsie ont montré une déconnexion de l'EZ du reste du cerveau, les études EEG de surface ayant démontré une diminution de la FC sortante de l'EZ, et les études d'IRM de diffusion ayant montré une connectivité structurelle préservée au sein de l'EZ et une diminution en dehors 2. D'autres études devraient examiner les liens entre les zones au sein de l'EZ, en dehors de l'EZ, et entre ces zones. Des études EEG ou MEG non invasives pourraient également estimer si la FC entrante vers l'EZ augmente réellement par rapport aux contrôles sains. Une autre stratégie pourrait consister à comparer des atlas normatifs de la FC à partir de canaux iEEG non pathologiques, bien qu'un tel atlas pour la FC dirigée n'ait pas encore été développé. Plusieurs études à différentes échelles sont donc nécessaires pour confirmer l'ISH. Ce travail ouvre également plusieurs voies de recherche. Premièrement, utiliser la PCA et d'autres techniques de décomposition sur la matrice de FC est prometteur pour généraliser les résultats du niveau de groupe au niveau du patient et permettre des analyses guidées par les données sans hypothèses préalables. Indubitablement, cela vaut la peine d'être développé dans les études de FC chez les patients atteints de troubles neurologiques. Cependant, la valeur clinique de ces nouvelles métriques dans la délimitation de l'EZ reste à évaluer, notamment en comparaison avec d'autres marqueurs ictaux et interictaux. Étant donné la pléthore de métriques suggérées pour localiser l'EZ, une inclusion exhaustive de diverses métriques pour démêler la valeur ajoutée de chacune est cruciale, ainsi que des tests statistiques appropriés tenant compte du déséquilibre de classe entre EZ / non-EZ. Une autre direction de recherche excitante est d'estimer comment la neuromodulation change le schéma de FC en fonction des résultats. Des travaux antérieurs ont montré qu'une diminution de la FC pendant les périodes de stimulation est associée à des résultats favorables 9. Investiguer si les répondeurs à la neuromodulation présentent un schéma de renforcement de la FC entrante vers l'EZ serait précieux. Il pourrait même être envisagé d'ajuster les paramètres de stimulation des patients pour maximiser cet effet en utilisant des données de FC non invasives. Un autre domaine en croissance est celui des jumeaux numériques, à savoir la modélisation in silico du comportement épileptique cérébral à partir des données des patients (généralement en utilisant la connectivité structurelle et les marqueurs d'excitabilité ictale) 10. Actuellement, ces modèles ne représentent pas les informations sur la direction de la connectivité. Intégrer des schémas de FC dirigée dans les modèles pourrait être intéressant pour explorer leur impact sur la performance dans la délimitation de l'EZ ou aider à définir la stratégie de traitement optimale (résection in silico ou neuromodulation). Enfin, malgré des avancées significatives dans la quantification de l'iEEG et les analyses de FC, le principal fossé restant est le manque d'intégration clinique de telles métriques dans la plupart des centres de chirurgie de l'épilepsie, ce qui empêche les patients de bénéficier de ces développements. Progresser vers des métriques faciles à utiliser, rapidement calculées dans des logiciels open source facile d’utilisation, et former les cliniciens à leur application est crucial.
Figure, brain Scientific
Légende de la figure
A) À partir des enregistrements SEEG interictaux (périodes avec et sans pointes), les auteurs ont estimé la connectivité fonctionnelle dirigée multivariée (FC) en évaluant comment les séries temporelles peuvent prédire l'avenir d'autres séries temporelles en utilisant la cohérence partielle dirigée basée sur le prinicpe de causalité de Granger.
B) Ils ont décomposé leur matrice de FC en composantes en utilisant l'analyse en composantes principales (PCA) avec des poids différents pour la FC entrante et sortante pour chaque canal. Ils ont systématiquement identifié une composante avec des poids élevés pour la FC entrante et faibles pour la FC sortante (composante 1 ici).
C) L'analyse des poids des canaux dans cette composante a révélé que les nœuds au sein de la zone épileptogène (EZ) présentent une FC entrante plus élevée que la FC sortante comparée aux autres zones. Les auteurs émettent l'hypothèse que cela est dû à une inhibition périphérique accrue vers l'EZ. Cependant, nous ne connaissons pas la source de cette FC entrante plus élevée.
D) Plusieurs études supplémentaires sont nécessaires : 1) pour confirmer que cette FC entrante plus élevée est vraiment due à une augmentation de la FC provenant des zones de propagation (PZ) et des zones non impliquées (NIZ), 2) pour comprendre si cette FC entrante est inhibitrice, et 3) pour examiner la valeur ajoutée de cette nouvelle méthode et des résultats dans le diagnostic et le traitement des épilepsies focales réfractaires aux médicaments.
Références
- Bartolomei F, Lagarde S, Wendling F, et al. Defining epileptogenic networks: Contribution of SEEG and signal analysis. Epilepsia. 2017;58(7):1131-1147. doi:10.1111/epi.13791
- Lagarde S, Benar CG, Wendling F, et al. Interictal Functional Connectivity in Focal Refractory Epilepsies Investigated by Intracranial EEG. Brain Connect. 2022;00(00). doi:10.1089/brain.2021.0190
- Narasimhan S, Kundassery KB, Gupta K, et al. Seizure-onset regions demonstrate high inward directed connectivity during resting-state: An SEEG study in focal epilepsy. Epilepsia. 2020;61(11):2534-2544. doi:10.1111/epi.16686
- Gunnarsdottir KM, Li A, Smith RJ, et al. Source-sink connectivity: A novel interictal EEG marker for seizure localization. Brain. 2022;145(11):3901-3915. doi:10.1093/brain/awac300
- Johnson GW, Doss DJ, Morgan VL, et al. The Interictal Suppression Hypothesis in focal epilepsy: network-level supporting evidence. Brain. Published online February 1, 2023. doi:10.1093/brain/awad016
- Doss DJ, Shless JS, Bick SK, et al. The interictal suppression hypothesis is the dominant differentiator of seizure onset zones in focal epilepsy. Brain. Published online June 14, 2024. doi:10.1093/brain/awae189
- Schevon CA, Weiss SA, McKhann G, et al. Evidence of an inhibitory restraint of seizure activity in humans. Nat Commun. 2012;3(1):1060. doi:10.1038/ncomms2056
- Allouch S, Yochum M, Kabbara A, et al. Mean-Field Modeling of Brain-Scale Dynamics for the Evaluation of EEG Source-Space Networks. Brain Topogr. 2022;35(1):54-65. doi:10.1007/s10548-021-00859-9
- Carron R, Roncon P, Lagarde S, Dibué M, Zanello M, Bartolomei F. Latest Views on the Mechanisms of Action of Surgically Implanted Cervical Vagal Nerve Stimulation in Epilepsy. Neuromodulation: Technology at the Neural Interface. Published online September 2022:1-9. doi:10.1016/j.neurom.2022.08.447
- Jirsa V, Wang H, Triebkorn P, et al. Personalised virtual brain models in epilepsy. Lancet Neurol. 2023;1998